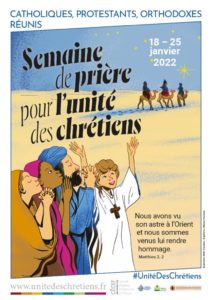Par l’Écriture, une relation plus forte avec Jésus
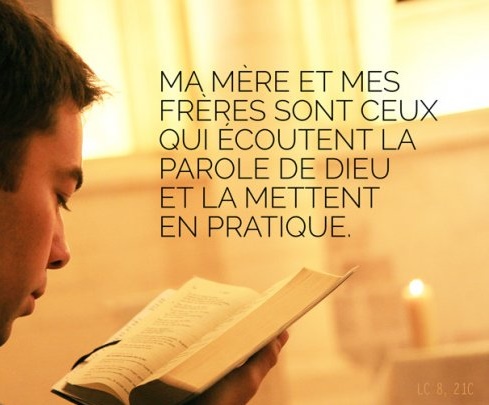
Voici une méditation pour le dimanche de la Parole
À la synagogue de Nazareth, Jésus referme le rouleau, le rend aux servants et s’assied. Tous tournent leurs regards vers lui et attendent son commentaire. Celui-ci est particulièrement bref et simple: «Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.»
Nous devons aussi penser à l’importance que l’Écriture doit avoir pour nous. Elle est notre principal moyen de connaître Jésus. Pour que nous puissions le rencontrer, l’Église nous a toujours proposé de lire des passages de l’Ancien Testament, surtout les prophéties qui se réfèrent à lui.
Jésus lui-même, après sa résurrection, a donné à ses Apôtres la clé d’interprétation de l’Écriture comme le rapporte saint Luc dans le chapitre conclusif de son Évangile (cf. Le 24, 27).
La Parole de Dieu contient nombre de prophéties et de prédictions qui s’accomplissent et s’actualisent dans la personne de Jésus. Celui qui veut connaître Jésus doit lire l’Écriture. Saint Jérôme dit que l’ignorance de l’Écriture, c’est l’ignorance du Christ. Il est important pour nous tous de lire l’Écriture.
L’Église veut nous mettre en contact avec elle dans chacune des liturgies.
Nous devons l’écouter avec attention, avec disponibilité. Les lectures qui nous sont proposées sont une nourriture spirituelle, une force pour aller de l’avant et une lumière qui guide notre chemin. Grâce à l’Écriture nous avons un contact plus profond avec Jésus, nous pouvons mieux le comprendre et, ainsi, nous laisser pleinement attirer par lui.
Cardinal Albert Vanhoye (+ 2021), jésuite français créé cardinal en 2006 par le pape Benoît XVI, professeur d’Écriture sainte et recteur de l’Institut biblique pontifical de Rome.