UN AMOUR IMMENSE ET ÉTERNEL
TROISIÈME JOUR DU TRIDUUM
Ouverture :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Ave Cor
Nous te saluons, Cœur très saint,
Nous te saluons, Cœur très doux,
Nous te saluons, Cœur très humble.
Nous te saluons, Cœur très pur,
Nous te saluons, Cœur donné sans réserve,
Nous te saluons, Cœur très sage,
Nous te saluons, Cœur très patient,
Nous te saluons, Cœur très obéissant.
Nous te saluons, Cœur très vigilant,
Nous te saluons, Cœur très fidèle,
Nous te saluons, Cœur bienheureux,
Nous te saluons, Cœur plein de miséricorde,
Nous te saluons, Cœur très aimant de Jésus et de Marie,
Nous t’adorons,
Nous te louons,
Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce,
Nous t’aimons,
De tout notre cœur,
De toute notre âme,
Et de toutes nos forces,
Nous t’offrons notre cœur,
Nous te le donnons,
Nous te le consacrons,
Nous te le sacrifions,
Reçois-le, possède-le tout entier,
Purifie-le,
Éclaire-le,
Sanctifie-le,
En lui, vis et règne, maintenant, toujours et à jamais.
Amen.
Lecture
LE CŒUR DE JÉSUS NOUS AIME D’UN AMOUR IMMENSE ET ÉTERNEL
Que le Cœur de Jésus nous aime d’un amour éternel et immense.
Premier point.
Le divin Cœur de notre Sauveur est rempli d’un amour éternel au regard de nous. Pour bien entendre ceci, il faut savoir qu’il y a deux choses dans l’éternité.
La première est qu’elle n’a ni commencement ni fin.
La seconde, qu’elle comprend en soit tous les temps passés, présents et à venir, c’est-à-dire toutes les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les moments passés, présents et à venir; et ce en une manière stable et permanente, car elle comprend toutes ces choses unies et jointes ensemble comme en un point indivisible.
Et c’est en quoi elle diffère d’avec le temps qui coule incessamment; de sorte que, un moment arrivant, l’autre s’écoule et se perd, et ainsi on ne voit jamais deux moments de temps ensemble. Mais tout est permanent dans l’éternité; ce qui est éternel demeure toujours en même consistance.
C’est pourquoi l’amour éternel du Cœur de Jésus envers nous comprend deux choses.
La première est que ce Cœur incomparable nous a aimés de toute éternité, avant que nous fussions, et que nous l’eussions connu et aimé; nonobstant même la vue et la connaissance qu’il avait de toutes les offenses que nous devions commettre contre lui, qui lui étaient aussi pré- sentes comme elles sont maintenant.
La seconde est qu’en chaque moment il nous aime de tout l’amour du- quel il nous a aimés et nous aimera en tous les moments qui se peuvent imaginer dans toute l’éternité. Et d’ici nous pouvons voir la différence qu’il y a entre l’amour de Dieu et le nôtre.
Car notre amour est une action passagère; mais celui de Dieu n’est pas de même, parce que l’amour qu’il a exercé au regard de nous depuis cent mille ans, est encore maintenant dans son Cœur avec celui qu’il exercera à cent mille ans d’ici.
Car l’éternité fait qu’en Dieu il n’y a rien de passé ni de futur, mais que tout y est présent. De sorte que Dieu nous aime maintenant de tout l’amour duquel il nous a aimés de toute éternité, et du- quel il nous aimera à toute éternité.
O éternité! ô éternité d’amour ô amour éternel! Si j’avais été de toute éternité, j’aurais dû vous aimer de toute éternité; mais, mon Dieu, je ne sais si j’ai encore commencé à vous aimer comme il faut. Du moins que je commence maintenant, ô mon Sauveur, à vous aimer autant que vous voulez que je vous aime.
O Dieu de mon cœur, je me donne à vous pour m’unir à l’amour duquel vous m’aimez de toute éternité, afin de vous aimer en ce même amour. Je me donne aussi à vous pour m’unir à l’amour duquel votre Père vous aime, et à l’amour duquel vous aimez votre Père avant tous les siècles, afin d’aimer le Père et le Fils d’un amour éternel. Second point. Le Cœur aimable de Jésus nous aime d’un amour immense.
Car l’amour divin et incréé qui possède ce Cœur adorable n’étant autre chose que Dieu même, et Dieu étant immense, cet amour est immense. Dieu étant partout, en tous lieux et en toutes choses, cet amour est partout, en tous lieux et en toutes choses. De sorte que le Cœur de Jésus ne nous aime pas seulement dans le ciel ou en quelque autre lieu; mais il nous aime dans le ciel et dans la terre, il nous aime dans le soleil, dans les étoiles et dans toutes les choses créées.
Il nous aime dans tous les cœurs de tous les habitants du ciel, et dans les cœurs de toutes les personnes qui ont quelque charité pour nous en la terre; car toute la charité qui est pour nous dans les cœurs du ciel et de la terre, est une participation de l’amour que le Cœur de Jésus a pour nous. Je dis bien davantage, c’est qu’il nous aimé même dans les cœurs de nos ennemis, nonobstant la haine qu’ils nous portent.
Voire j’ose dire qu’il nous aime dans les enfers, dans les cœurs des démons et des damnés, malgré toute la rage qu’ils ont contre nous, puisque ce divin amour est partout et remplit le ciel et la terre comme Dieu.
O amour immense, je me perds et me plonge dans vos feux et dans vs flammes qui remplissent tout l’être créé, pour aimer mon Dieu et mon Sauveur en tous lieux et en toutes choses.
O Jésus, je vous offre tout l’amour immense de votre Cœur, du Cœur adorable de votre divin Père, du Cœur aimable de votre sainte Mère, et de tous les cœurs qui vous aiment au ciel et en la terre; et je désire ardemment que toutes les créatures de l’univers soient converties en feux et en flammes d’amour vers vous. (OCVIII, p.340-342, quatrième méditation)
Oraison finale : Très sainte Trinité, que des louanges infinies te soient rendues éternellement pour tous les miracles d’amour que tu opères dans le Cœur de mon Jésus! Je t’offre le mien, et celui de tous mes frères, te suppliant, avec soumission d’en prendre entière possession d’y annihiler tout ce qui te déplait pour y établir en tous le règne de ton amour souverain. Amen.

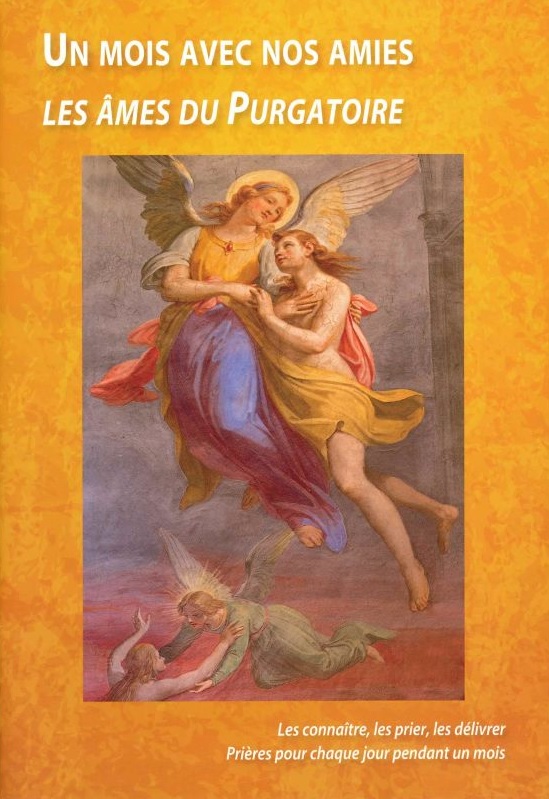
 Ave Cor
Ave Cor