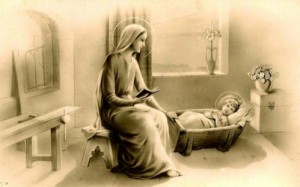Sainte Geneviève 1600e anniversaire – neuvaine Jour 5
Dans Paris, ce début d’année 2020 est marqué par une neuvaine qui s’achèvera le 11 janvier, jour du 1600e anniversaire de la naissance de sa sainte patronne, Geneviève.
1 . Commencer par l’invocation à l’Esprit Saint suivie de la prière de la neuvaine
2 . Dire la prière du jour de la neuvaine
3. Terminer par la prière finale, ou une prière selon son cœur.
On peut y ajouter, un Notre Père et un Gloire au Père,
ou une dizaine de chapelet, ou toute autre prière.
Invocation au Saint Esprit
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs.
Envoie du haut du Ciel un rayon de ta lumière
Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons
Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain
Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts,
A l’Esprit Saint consolateur, maintenant et dans les siècles. Amen
Prière de la neuvaine

Seigneur, Toi qui connais la pensée la plus secrète,
Tu sais quel souci occupe mon cœur en ce moment.
Je m’adresse à toi avec la confiance et l’abandon d’un enfant,
sûr que tu exauces toujours les prières
pour le plus grand bien de nos âmes.
Je te supplie d’exaucer l’instante supplication
que je t’adresse
par l’intercession de Sainte Geneviève
(formuler ici l’intention spécifique de la neuvaine).
Je te le demande, Père des Cieux, bien-aimé, qui vis et règnes
avec Jésus-Christ, ton Fils, et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen !
Prière du Jour 5
Sainte Geneviève,
tu t’es penchée avec miséricorde et tendresse sur les exclus de ton époque,
les pauvres, les condamnés, et les prisonniers, sur tous ceux que la vie écrasait.
Tu les as secourus, consolés, rendus à l’espérance.
Tu n’as jamais séparé la foi des œuvres,
sachant que » sans les œuvres, la foi est tout à fait morte » (Jc 2, 17).
Notre siècle, qui avait rêvé d’éliminer toute détresse par » la Science et le Progrès « ,
sans référence au Dieu Tout-Puissant, s’achève sur le spectacle déchirant
d’immenses foules d’exclus de toutes sortes, témoins de l’échec
d’une humanité orgueilleuse qui s’est forgé ses propres lois,
à l’écart de l’Évangile qui récapitule et restaure toutes choses en Jésus-Christ.
Que ton exemple illumine et féconde les âmes
de nos contemporains et de nos dirigeants,
afin qu’ils s’inspirent, dans leur vie et leur action,
des principes impérissables de l’Évangile.
Ainsi le Règne de Dieu sera-t-il proclamé et réalisé dans la cité terrestre,
à l’aube du troisième millénaire après Jésus-Christ.
Intercède auprès du Seigneur, Sainte Geneviève,
qui es un exemple de justice et de solidarité,
pour que mon cœur s’ouvre pleinement à l’amour agissant du prochain ;
que j’apprenne surtout à témoigner de la tendresse aux malheureux
et à partager mes biens avec les nécessiteux,
en leur donnant la dîme exigée par l’Écriture :
» De tout ce que Tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme » (Gn 28, 22)
Demande au Seigneur d’exaucer l’intention de la neuvaine qui me tient tant à cœur.
Ainsi pourrai-je croître dans son amour et faire mieux connaître autour de moi
l’histoire du salut en Jésus-Christ, l’unique Sauveur du monde. Amen!
Prière d’action de grâce finale
Seigneur, ne me relâche pas ton amour,
continue à me purifier et à me protéger !
Sans toi je ne suis rien ; ne me prive jamais de ta grâce.
Mon âme a soif de ta présence,
» mon cœur et ma chair sont un cri vers toi, ô Dieu vivant » (Ps 83, 3)
Par l’intercession de Sainte Geneviève,
accorde-moi la grâce que j’ai demandée tout au long de la neuvaine.
Je suis sûr(e) d’être exaucée, Seigneur, car je t’aime
de tout mon cœur, de toute mon âme, par dessus tout,
sachant que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t’aiment.
Aussi si tu en pouvais, pour des raisons que toi seul connais,
m’accorder tout ce que je te demande,
je sais que tu accorderas bien plus à ceux que j’aime et à moi-même,
car tu accordes toujours au centuple ce que demandent tes enfants,
pour leur plus grand bien. Amen!