Une prière «pour les femmes jetées, pour les femmes utilisées, pour les filles qui doivent vendre leur propre dignité pour avoir un poste de travail». L’Évangile du jour, tiré du texte de saint Matthieu, nous donne les paroles du Christ : «Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l’adultère» et «quiconque répudie sa propre femme l’expose à l’adultère.»
Jésus change l’histoire
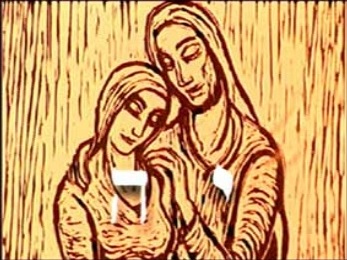
Les femmes sont «ce qui manque à tous les hommes pour être image et ressemblance de Dieu». Jésus prononce des paroles fortes, radicales, qui «changent l’histoire» parce qu’à ce moment la femme «était de seconde classe», pour le dire avec un euphémisme, elle «était esclave», elle «ne jouissait même pas de la pleine liberté».
«Et la doctrine de Jésus sur la femme change l’histoire. Un chose est la femme avant Jésus, une autre chose est la femme après Jésus. Jésus rend la femme digne et la met au même niveau que l’homme, parce qu’il prend cette première parole du Créateur, tous les deux sont “image et ressemblance de Dieu”, tous les deux ; non pas d’abord l’homme et ensuite un peu plus bas la femme, non, tous les deux. Et l’homme sans la femme à ses côtés, que ce soit comme maman, comme sœur, comme épouse, comme compagne de travail, comme amie-, cet homme seul n’est pas image de Dieu.»
Aujourd’hui, la femme est trop souvent instrumentalisée comme objet de désir. «Désirer» une femme, comme l’évoque l’extrait évangélique du jour. «Dans les programmes télévisés, dans les revues, dans les journaux, on fait voir les femmes comme un objet du désir, jetable, comme dans un supermarché».
La femme devient un objet, «humiliée, sans vêtements», ce qui va à l’encontre de l’enseignement de Jésus, qui, au contraire, la «rend digne». Il ne faut pas aller loin pour constater l’instrumentalisation des femmes : «Ici, là où nous habitons, dans les bureaux, dans les entreprises», les femmes sont souvent utilisées comme des «produits jetables» et même pas considérées comme des personnes à part entière.
«Ceci est un péché contre Dieu le Créateur, rejeter la femme, parce que sans elle, nous les garçons, nous ne pouvons pas être image et ressemblance de Dieu. Il y a un acharnement contre la femme, un acharnement mauvais. Même sans le dire. Mais combien de fois des filles, pour avoir un poste de travail, doivent se vendre comme des objets jetables ?» Et ce phénomène se constate ici même, à Rome.
Regarder autour pour voir l’exploitation
Que nous pourrions voir si nous faisions un «pèlerinage nocturne» dans certains endroits de la ville, où «de nombreuses femmes, de nombreuses migrantes ou non-migrantes» sont exploitées «comme dans un marché»! Les hommes s’approchent de ces femmes non pas pour leur dire «bonsoir» mais «combien tu coûtes ?» Face à notre liberté, ces femmes sont «esclaves de cette pensée du déchet».
«Tout ceci arrive ici, à Rome, et dans chaque ville. Les femmes anonymes, les femmes, nous pouvons dire, “sans regard”, parce que la honte recouvre le regard, les femmes qui ne savent pas rire et beaucoup d’entre elles ne connaissent pas la joie d’allaiter et de s’entendre dire “maman”. Mais aussi dans la vie quotidienne, sans aller à ces endroits, cette mauvaise pensée de rejeter la femme, comme un objet de “seconde classe”. Nous devrions mieux réfléchir. Et en faisant cela ou en disant cela, en entrant dans cette pensée nous méprisons l’image de Dieu, qui a fait l’homme et la femme ensemble à son image et ressemblance. Que ce passage de l’Évangile nous aide à penser au marché des femmes, à la traite, à l’exploitation que l’on voit, et aussi au marché que l’on ne voit pas, celui qui se fait et ne se voit pas. La femme est bafouée parce qu’elle est une femme.»
Jésus rend la dignité avec tendresse
Jésus «a eu une maman», il a eu «beaucoup d’amies qui le suivaient pour l’aider dans son ministère» et pour le soutenir. Il a rencontré «beaucoup de femmes méprisées, marginalisées, écartées», qu’il a soulagé avec beaucoup de tendresse, en leur rendant leur dignité.


