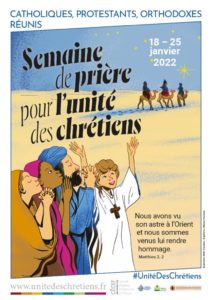La tendresse, un moyen de toucher ce qui est fragile en nous
Le Pape François a continué sa catéchèse sur la figure de Saint Joseph lors de l’audience générale ce mercredi 19 janvier, s’arrêtant en particulier sur le «père de tendresse». «Cela nous fait du bien de nous refléter dans la paternité de Joseph.»
PAPE FRANÇOIS
AUDIENCE GÉNÉRALE
Salle Paul VI
Mercredi 19 janvier 2022
______________________________
Catéchèse sur saint Joseph – 8. Saint Joseph père dans la tendresse
Résumé
Aujourd’hui, nous approfondissons la figure de saint Joseph comme père de tendresse. Dans les évangiles, Jésus utilise souvent la figure du Père pour parler de Dieu et de son amour. Ainsi, la parabole du Père miséricordieux (Lc 15, 11-32) insiste sur la manière dont le pardon atteint celui qui a péché.
Le fils prodigue s’attend à une punition, ou à une justice qui lui aurait donné tout au plus la place d’un des serviteurs, mais il se retrouve dans les bras de son père. La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde, elle est une façon inattendue de rendre justice.
Il y a une grande tendresse dans l’amour de Dieu, et il est beau de penser que la première personne à transmettre cela à Jésus fut Joseph lui-même. Il est essentiel de faire nous-même l’expérience de cette tendresse de Dieu pour en devenir les témoins. Ce n’est pas une question d’émotion ou de sentiment, mais la conviction de se sentir aimé et accueilli précisément dans notre pauvreté et notre misère.
Le sacrement de la réconciliation est ainsi le lieu par excellence pour faire l’expérience de cette tendresse de Dieu pour nous, en toute vérité. C’est en nous laissant aimer que nous devenons à notre tour capable d’aimer davantage.
Catéchèse
Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, je voudrais approfondir la figure de Saint Joseph comme père de tendresse.
Dans ma Lettre Apostolique Patris corde (8 décembre 2020), j’ai eu l’occasion de réfléchir à cet aspect de la tendresse, un aspect de la personnalité de saint Joseph. En effet, même si les Évangiles ne nous donnent aucun détail sur la manière dont il a exercé sa paternité, nous pouvons être sûrs que le fait qu’il soit un homme « juste » s’est également traduit dans l’éducation donnée à Jésus.
« Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » (Lc 2, 52) : C’est ce que dit l’Évangile. Comme le Seigneur le fit avec Israël, il lui a « appris à marcher, a Jésus, en le tenant par la main ; il était pour lui comme le père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue ; il se penchait vers lui pour le nourrir » (cf. Os 11, 3-4) » (Patris corde, 2).
Elle est belle cette définition de la Bible qui fait voir la relation de Dieu avec le peuple d’Israël. Et nous pensons que c’est la même relation celle de St Joseph avec Jésus.
*
Les évangiles témoignent que Jésus a toujours utilisé le mot « père » pour parler de Dieu et de son amour. De nombreuses paraboles ont comme protagoniste la figure du père [1]. L’une des plus célèbres est certainement celle du Père miséricordieux, racontée par l’évangéliste Luc (cf. Lc 15, 11-32).
Cette parabole met l’accent par-delà l’expérience du péché et du pardon, sur la manière dont le pardon atteint la personne qui a commis une faute. Le texte dit : « Comme il était encore loin de la maison – le fils pécheur qui s’était éloigné – quand il était encore loin son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. » (v. 20).
Le fils s’attendait à une punition, une justice qui, tout au plus, aurait pu lui donner la place d’un des serviteurs, mais il se retrouve enveloppé dans l’étreinte de son père. La tendresse est quelque chose de plus grand que la logique du monde. C’est une façon inattendue de rendre justice.
C’est pourquoi nous ne devons jamais oublier que Dieu n’est pas effrayé par nos péchés : mettons-nous cela bien en tête. Dieu n’est pas effrayé par nos péchés, il est plus grand que nos péchés. Il est père, il est amour, il est tendre. Il n’est pas effrayé par nos péchés, nos erreurs, nos chutes, mais il est effrayé par la fermeture de notre cœur – cela oui le fait souffrir – il est effrayé par notre manque de foi en son amour.
Il y a une grande tendresse dans l’expérience de l’amour de Dieu. Et c’est beau de penser que la première personne à transmettre cette réalité à Jésus a été Joseph lui-même. Car les choses de Dieu nous parviennent toujours par la médiation d’expériences humaines.
Il y a quelque temps – je ne sais pas si je vous l’ai déjà raconté – un groupe de jeunes gens qui font du théâtre, un groupe de jeunes gens pop, « en avance sur leur temps », a été frappé par cette parabole du père miséricordieux et a décidé de faire une œuvre de théâtre pop avec ce sujet, avec cette histoire. Et ils l’ont bien fait.
Et tout l’argument est, à la fin, qu’un ami écoute le fils qui s’est éloigné de son père, qui voulait rentrer à la maison mais qui avait peur que son père le mette dehors et le punisse et toutes ces choses. Et l’ami lui dit, dans cet opéra pop : « Envoie un messager et dis que tu veux rentrer chez toi, et si le père le reçoit, qu’il mette un mouchoir à la fenêtre, la fenêtre que tu verras dès que tu prendras le dernier chemin ».
Cela a été donc fait. Et l’opéra, avec des chants et des danses, continue jusqu’au moment où le fils emprunte le chemin final et l’on voit la maison. Et quand il lève les yeux, il voit la maison pleine de mouchoirs blancs : pleine. Pas une, toutes les fenêtres, trois ou quatre par fenêtre.
C’est ça la miséricorde de Dieu. Il n’a pas peur de notre passé, de nos mauvaises choses : non. Il a seulement peur de la fermeture. Donc… nous avons tous des comptes à régler ; mais régler ses comptes avec Dieu est une très belle chose, car nous commençons à parler et Lui nous embrasse. La tendresse.
*
Nous pouvons donc nous demander si nous avons nous-mêmes fait l’expérience de cette tendresse, et si nous en sommes devenus à notre tour les témoins. Pensons. Car la tendresse n’est pas d’abord une affaire d’émotion ou de sentiment : non. C’est l’expérience de se sentir aimé et accueilli précisément dans notre pauvreté et dans notre misère, et ainsi transformé par l’amour de Dieu.
Dieu ne compte pas seulement sur nos talents : non, mais aussi sur notre faiblesse rachetée. Notre faiblesse est rachetée et Lui s’appuie sur cela. Ce qui fait dire à saint Paul, par exemple, qu’il y a un plan aussi pour sa fragilité.
En effet, il écrit à la communauté de Corinthe : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler […] C’est pourquoi par trois fois, j’ai prié le Seigneur d’écarter cela de moi. Et il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2 Cor 12, 7-9).
Le Seigneur ne supprime pas toutes les faiblesses, mais il nous aide à marcher avec les faiblesses, en nous prenant Lui-même par la main. Mais comment ? Oui, Il prend nos faiblesses par la main, nous avec les faiblesses, près de nous. Et c’est ça la tendresse.
L’expérience de la tendresse consiste à voir la puissance de Dieu traverser précisément ce qui nous rend plus fragiles ; à condition toutefois de nous convertir du regard du Malin qui « nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif », tandis que l’Esprit Saint « la met en lumière avec tendresse » (Patris corde, 2).
« La tendresse est le meilleur moyen de toucher ce qui est fragile en nous. […] Voyez comment les infirmières et les infirmiers touchent les plaies des malades : avec tendresse, pour ne pas les blesser davantage. C’est ainsi que le Seigneur touche nos blessures, avec la même tendresse.
C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, dans la prière personnelle avec Dieu, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité : lui, c’est un menteur, mais il s’arrange pour nous dire la vérité afin de me conduire au mensonge. Mais s’il le fait, le malin le fait et c’est pour nous condamner.
Le Seigneur nous dit la vérité et nous tends la main pour nous sauver. Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne » (Patris corde, 2). Dieu pardonne toujours : mettez cela dans la tête et le cœur. Dieu pardonne toujours. C’est nous qui nous fatiguons à demander le pardon. Mais il pardonne toujours. Les choses les plus laides.
*
Cela nous fait donc du bien de nous contempler dans la paternité de Joseph qui est un miroir de la paternité de Dieu, et de nous demander si nous permettons au Seigneur de nous aimer avec sa tendresse, transformant chacun de nous en hommes et en femmes capables d’aimer de cette manière.
Sans cette « révolution de la tendresse » – une révolution de la tendresse est nécessaire ! – et sans cette révolution de la tendresse nous risquons de rester emprisonnés dans une justice qui ne nous permet pas de nous relever facilement et qui confond la rédemption avec la punition.
C’est pourquoi, aujourd’hui, je veux me souvenir d’une façon particulière de nos frères et sœurs qui sont en prison. Il est juste que qui a commis une faute paie pour son erreur, mais il est encore plus juste que qui a commis une faute puisse se racheter de son erreur.
Il ne peut y avoir de condamnations sans une fenêtre d’espérance. Toute condamnation comporte toujours une fenêtre d’espérance. Pensons à nos frères et sœurs en prison, pensons à la tendresse de Dieu pour eux, et prions pour eux, afin qu’ils trouvent dans cette fenêtre d’espérance un passage vers une vie meilleure.
Et nous concluons avec cette prière :
Saint Joseph, père dans la tendresse,
apprends nous à accepter d’être aimés précisément dans ce qui en nous est plus faible.
Accorde-nous de ne placer aucun obstacle
entre notre pauvreté et la grandeur de l’amour de Dieu.
Suscite en nous le désir de nous approcher de la Réconciliation,
pour être pardonnés et aussi rendus capables d’aimer avec tendresse
nos frères et sœurs dans leur pauvreté.
Sois proche de ceux qui ont fait le mal et qui en paient le prix ;
Aide-les à trouver ensemble avec la justice également la tendresse pour pouvoir recommencer.
Et apprends leur que le premier moyen pour recommencer
est de demander sincèrement pardon, pour sentir la caresse du Père.
Merci.
______________________________
[1] Cfr Mt 15,13; 21,28-30; 22,2; Lc 15,11-32; Jn 5,19-23; 6,32-40; 14,2;15,1.8.
SALUTATIONS
Je salue cordialement les personnes de langue française présentes aujourd’hui. Ce matin, prions tout particulièrement pour ceux qui sont en prison. Que la tendresse de Dieu les rejoigne dans leur chemin de réparation et de réinsertion dans la société, et qu’elle suscite en chacun d’entre nous un grand désir de conversion. Que Dieu vous bénisse !
Je salue les pèlerins et visiteurs anglophones, en particulier ceux des États-Unis d’Amérique. Je salue également les prêtres de l’Institut de formation théologique continue du Collège pontifical nord-américain. En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, prions pour que tous les disciples du Christ persévèrent sur le chemin de l’unité. Sur vous tous et sur vos familles, j’invoque la joie et la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse!
Je salue les fidèles germanophones. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu et des autres. Nous aussi, nous sommes donc appelés à être miséricordieux et prêts à pardonner. Que Saint Joseph, père dans la tendresse, vous enseigne cette attitude de miséricorde et vous accompagne de son intercession.
Je salue cordialement les fidèles hispanophones. Je vous invite à aborder une attitude de Réconciliation pour expérimenter la miséricorde et la tendresse de Dieu, qui nous aide à surmonter nos chutes, à nous relever et à apprendre à aimer selon la mesure de son Cœur paternel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Avec des sentiments d’estime fraternelle, je vous salue chers frères et sœurs qui professez, en portugais, la foi dans l’unique Seigneur de tous les peuples et de toutes les langues. Je vous encourage, en bannissant toute forme d’indifférence, de confusion et de rivalité haineuse, à collaborer avec tous les chrétiens pour l’amour du Christ. Unissons-nous tous en son Nom ! Moi aussi, en son nom, je vous bénis, souhaitant que vous portiez beaucoup de fruits dans la paix, la coopération et l’unité entre votre famille et vos compatriotes.
Je salue les fidèles arabophones. Nous demandons à saint Joseph, père dans la tendresse, de susciter en nous le désir de nous approcher du sacrement de la réconciliation, d’être pardonnés et rendus capables d’aimer nos frères et sœurs dans leur pauvreté, et d’être proches de ceux qui ont tort, en leur apprenant que la première façon de recommencer est de demander sincèrement pardon. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal !
Je salue cordialement tous les Polonais. Hier, nous avons commencé la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. C’est le devoir de chaque baptisé de s’engager dans ce que Jésus a voulu : que tous soient un. Je vous invite à prier pour que tous les chrétiens, découvrant la tendresse de l’amour de Dieu, s’aiment les uns les autres. Je vous bénis de tout mon cœur !
APPEL
Ma pensée va aux populations des îles Tonga, qui ont été touchées ces derniers jours par l’éruption du volcan sous-marin qui a causé d’importants dégâts matériels. Je suis spirituellement proche de toutes les personnes affligées, implorant Dieu de les soulager de leurs souffrances. J’invite tout le monde à se joindre à moi pour prier pour ces frères et sœurs.
***
Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. En particulier, je salue les participantes au Chapitre général des Filles des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie (Institut Ravasco), les Sœurs de la Mère de Dieu venues de Roumanie, les élèves des Inspecteurs et Surintendants de la Guardia di Finanza de L’Aquila, et membres de la Fondation « Davida » de Leinì (Turin).
Je vous exhorte tous à être, à l’exemple de saint Joseph, témoins de la tendresse et de la miséricorde du Seigneur. Ensuite, je salue les travailleurs de la compagnie aérienne AirItaly, et j’espère que leur situation de travail pourra trouver une solution positive, dans le respect des droits de tous, en particulier des familles.
Enfin, mes pensées vont de manière particulière aux personnes âgées, aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui a commencé hier, nous invite à demander au Seigneur avec insistance le don de la pleine communion entre les croyants. Ma bénédiction à tous.
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
Texte présenté (et traduit pour les Salutations) par l’Association de la Médaille Miraculeuse