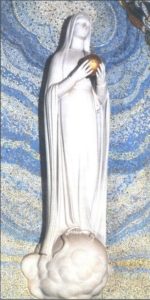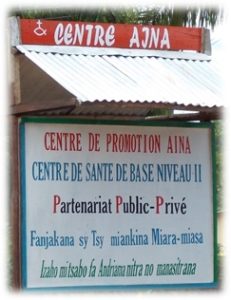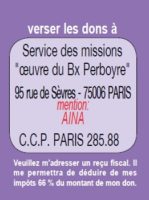Le Pape encourage les prêtres à «donner leur vie en servant»
MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Basilique Saint Pierre – Autel de la Cathèdre
Jeudi Saint, 9 avril 2020
L’Eucharistie.
La réalité que nous vivons aujourd’hui dans cette célébration: le Seigneur qui veut rester avec nous dans l’Eucharistie. Et nous devenons toujours des tabernacles du Seigneur, nous amenons le Seigneur avec nous; au point qu’il nous dit lui-même que si nous ne mangeons pas son corps et ne buvons pas son sang, nous n’entrerons pas dans le Royaume des Cieux. Tel est le mystère du pain et du vin du Seigneur avec nous, en nous, en nous.
Le service.
Ce geste qui est une condition pour entrer dans le Royaume des Cieux. Servir, oui, tout le monde. Mais le Seigneur, dans cet échange de paroles qu’il a eu avec Pierre (cf. Jn 13, 6-9), lui fait comprendre que pour entrer dans le Royaume des Cieux, nous devons laisser le Seigneur nous servir, que le Serviteur de Dieu est le serviteur de nous tous
Et c’est difficile à comprendre. Si je ne laisse pas le Seigneur être mon serviteur, que le Seigneur me lave, me fasse grandir, me pardonne, je n’entrerai pas dans le Royaume des Cieux.
Et la prêtrise.
Aujourd’hui, je voudrais être proche des prêtres, de tous les prêtres, du dernier ordonné au Pape, nous sommes tous prêtres. Les évêques, tous … Nous sommes oints, oints par le Seigneur; oint pour faire l’Eucharistie, oint pour servir.
Aujourd’hui, il n’y a pas de messe chrismale – j’espère que nous pourrons l’avoir avant la Pentecôte, sinon nous devrons la reporter à l’année prochaine – mais je ne peux pas laisser passer cette messe sans me souvenir des prêtres.
Des prêtres qui offrent leur vie pour le Seigneur, des prêtres qui sont des serviteurs. En ces jours, plus de soixante sont morts ici, en Italie, dans l’attention aux malades dans les hôpitaux, et aussi chez les médecins, les infirmiers, les infirmières … Ce sont « les saints d’à côté », des prêtres qui ont donné leur vie en servant . Et je pense à ceux qui sont loin.
Aujourd’hui, j’ai reçu une lettre d’un prêtre, aumônier d’une prison éloignée, qui raconte comment il vit cette semaine sainte avec les prisonniers. Un franciscain. Des prêtres qui vont loin pour apporter l’Évangile et y meurent.
Un évêque a dit que la première chose qu’il a faite, quand il est arrivé dans ces postes de mission, a été d’aller au cimetière, sur la tombe des prêtres qui y ont laissé leur vie, jeunes, pour la peste locale [maladies locales]: ils n’étaient pas préparés, ils n’avaient pas d’anticorps, eux. Personne ne connaît leur nom: des prêtres anonymes.
Les curés de la campagne, qui sont des curés de quatre, cinq, sept villages, dans les montagnes, et vont de l’un à l’autre, qui connaissent le peuple … Une fois, on m’a dit qu’il connaissait le nom de tout le peuple des pays. « Vraiment? » Lui dis-je. Et il m’a dit: « Même le nom des chiens! » Ils le savent tous. Proximité sacerdotale. Bravo, bons prêtres.
Aujourd’hui, je vous porte dans mon cœur et je vous amène à l’autel. Prêtres calomniés. Souvent, cela arrive aujourd’hui, ils ne peuvent pas aller dans la rue parce qu’on leur dit de mauvaises choses, en référence au drame que nous avons vécu avec la découverte des prêtres qui ont fait de mauvaises choses. Certains m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas quitter la maison comme pasteurs parce qu’on les insultait; et ça continue.
Des prêtres pécheurs qui, avec les évêques et le pape pécheur, n’oublient pas de demander pardon et apprennent à pardonner, car ils savent qu’ils ont besoin de demander pardon et de pardonner. Nous sommes tous des pécheurs. Les prêtres qui souffrent des crises, qui ne savent pas quoi faire, qui sont dans le noir …
Aujourd’hui, vous tous, frères prêtres, vous êtes avec moi à l’autel, vous, consacrés. Je ne vous dis qu’une chose: ne soyez pas aussi têtu que Pierre. Laissez-vous laver les pieds.
Et donc, avec cette conscience du besoin d’être lavé, soyez de grands pardonneurs ! Pardonnez! Grand cœur de générosité dans le pardon. C’est la mesure par laquelle nous serons mesurés. Comme vous avez pardonné, vous serez pardonné: la même mesure.
N’ayez pas peur de pardonner. Parfois, il y a des doutes … Regardez le Christ [regardez le Crucifix]. Il y a là le pardon de tout le monde. Soyez courageux; aussi à risquer, à pardonner, pour consoler. Et si vous ne pouvez pas donner le pardon sacramentel à ce moment-là, donnez au moins la consolation d’un frère qui accompagne et laisse la porte ouverte pour que [cette personne] revienne.
Je remercie Dieu pour la grâce de la prêtrise, nous tous [merci]. Je remercie Dieu pour vous, prêtres. Jésus vous aime! Il vous demande seulement de laisser vos pieds être lavés.