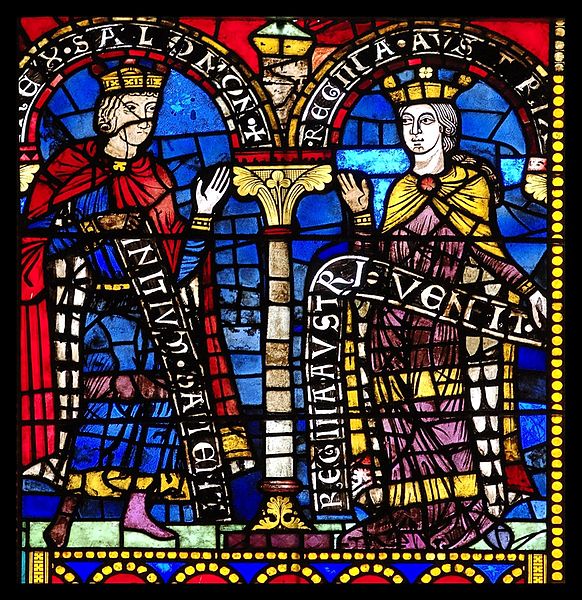Au lendemain de la Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humain, le Pape François a reçu ce vendredi matin 9 février les membres du groupe Sainte-Marthe, une organisation informelle qui regroupe des personnalités des forces de l’ordre, du monde de la recherche universitaire, des politiques et des religieux «pour affronter les causes et les effets de ce fléau moderne, qui continue à causer d’indicibles souffrances humaines».
Dans une courte intervention, le Pape a dit son espérance que ces journées «de réflexion et d’échange d’expériences aient mis dans une lumière plus claire l’interaction des problématiques globales et locales de la traite des personnes humaines. L’expérience montre que ces formes modernes d’esclavage sont bien plus répandues que ce que l’on peut imaginer, y compris, pour notre honte et scandale, à l’intérieur des plus prospères de nos sociétés.»
S’appuyant sur ce cri de Dieu adressé à Caïn dans les premières pages de la Bible, «où est ton frère ?», le Pape a invité à «examiner sérieusement les différentes formes de complicité avec lesquelles la société tolère et encourage, particulièrement à propos de la traite à fins sexuelles, l’exploitation d’hommes, de femmes et d’enfants vulnérables».
Il a appelé une nouvelle fois le monde de la recherche universitaire et les médias à s’investir dans ce domaine, afin de développer «la conscience de la nécessité croissante d’aider les victimes de ces crimes, en les accompagnant dans un chemin de réintégration dans la société et de rétablissement de leur dignité humaine».
L’Église, en apportant le «baume de la miséricorde» aux victimes de ces réseaux, a un rôle essentiel à jouer pour «le redressement et le renouvellement de la société dans son ensemble.»