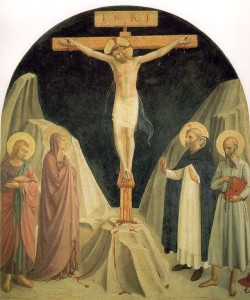Le bienheureux Noël Pinot, prêtre et martyr de 1794
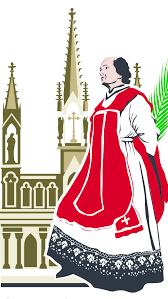
À l’ouest de l’Anjou, la paroisse du Louroux-Béconnais honore le bienheureux Noël Pinot, pour le 232e anniversaire de son martyre sous la Révolution. Ce curé du lieu est honoré d’un véritable culte local.
Il est allé à l’échafaud en habits liturgiques et a gravi les marches le menant à la guillotine comme à l’autel pour la célébration eucharistique ! Sa foi frappa les esprits ce 21 février 1794, sur la place du Ralliement, à Angers.
Il avait exprimé les premières paroles de la messe : « Introibo ad altare Dei » c’est-à-dire « je m’approcherai de l’autel de Dieu » et avant de mourir : « Mon Dieu qui avez donné votre vie pour moi, qu’avec plaisir je donne la mienne pour vous. » Noël Pinot s’est identifié au Christ jusqu’au bout : comme le Christ il mourut le vendredi, à 15 heures, à 47 ans.
Prêtre réfractaire
Son oblation avait commencé quelques jours plus tôt, le 8 février, lorsqu’il fut arrêté à minuit, dans une grange du hameau de la Milandrie, à quelques kilomètres de sa paroisse du Louroux-Béconnais. Un ancien protégé l’ayant dénoncé, les républicains trouvèrent ce curé réfractaire caché dans un coffre en bois. Muni de ses habits liturgiques, il était venu célébrer clandestinement la messe.
Comme le Christ, le Vendredi saint, il subit alors coups, injures et crachats. Les révolutionnaires profanent les hosties consacrées qu’il porte sur lui. Comme son Maître, il vivra son jugement sous les outrages, le président du tribunal révolutionnaire d’Angers, prêtre défroqué, souhaitant qu’il aille au supplice avec ses habits sacerdotaux. Comme son Seigneur, il aura son chemin de Croix pour le conduire à l’échafaud dans la rue la plus anticléricale de la ville, dans une parodie de procession.
Les habitants de la Milandrie salueront Noël Pinot lors de son arrestation. En chemin, il remettra son chapelet à une petite fille en lui disant de se souvenir de lui. Avant sa vie clandestine de prêtre réfractaire qui dura trois ans, il avait obtenu à 41 ans un diplôme de « maître ès arts » à l’université d’Angers, ce qui lui permettait d’avoir la charge d’une paroisse.
Il voulut, dans son presbytère du Louroux-Béconnais, être le plus pauvre des pauvres aux côtés des démunis. Mais les révolutionnaires exigeaient qu’il prêtât serment sur la Constitution civile du clergé. Noël Pinot écouta alors sa conscience et monta courageusement en chaire, après la messe, le 21 février 1791, pour expliquer pourquoi l’Église en cela n’avait pas à se soumettre à l’État et faire de lui un fonctionnaire. Il a pratiqué le don de soi jusqu’au bout.