EUCHARISTIE MÉDITÉE 22
Solitude, repos, loi d’amour.
Je la conduirai dans la solitude et je parlerai à son cœur. Osée 2, 16
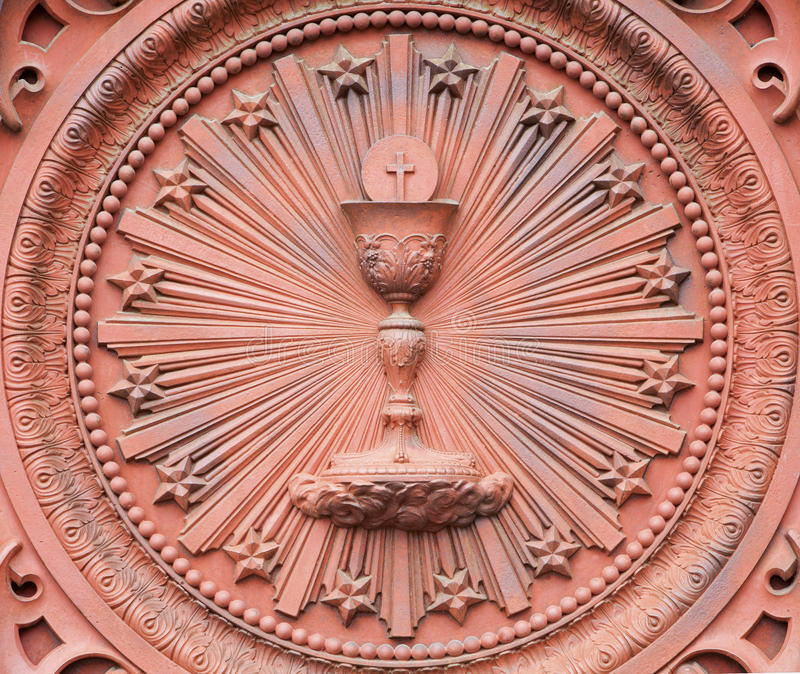
22e ACTION DE GRÂCES.
O Jésus, hôte divin du tabernacle, Dieu caché dans votre Eucharistie, je vous adore dans le fond de mon cœur. Vous voulez aussi y être seul, ô bien-aimé, et qu’il soit comme un jardin fermé où nul autre que vous ne puisse pénétrer.
Ce que vous voulez, je le veux aussi, Seigneur, mais je ne le puis sans le secours de votre sainte grâce. Daignez donc faire vous-même le vide dans ce cœur où vous n’avez pas dédaigné de descendre.
Embellissez cette solitude, elle est aride, c’est le désert, vous n’y trouverez que des ronces et des épines, brûlez-les au feu de votre amour, faites croître à leur place les vertus qui vous sont chères, et faites-y couler avec abondance l’eau vivifiante de votre grâce, qui seule peut faire produire les fruits de salut et de vie.
Recueillez en vous, ô Jésus, toutes les puissances de mon âme, afin qu’elle puisse s’entretenir seule à seule avec vous, et ne rien perdre des heureux, mais trop courts instants où elle a le bonheur de vous recevoir.
Que le monde disparaisse pour moi, que ses vains bruits ne viennent pas troubler la douce paix donc je jouis avec vous ; que toutes les créatures s’effacent de mon souvenir et me laissent au moins quelques instants jouir de mon Créateur et être tout à lui.
Que les préoccupations de la vie présente, les soucis, les agitations qui si souvent troublent mon cœur, s’évanouissent aussi en présence du Dieu de l’éternité, de ce Dieu qui est à la fois mon premier principe et ma dernière fin.
Vous le savez, ô Jésus, mon âme n’aspire qu’à vous, elle ne désire, elle ne veut, elle ne cherche que vous. Tout ce qui n’est pas vous ne saurait la satisfaire, et le monde est pour elle un désert où elle se consume dans la douleur et dans les larmes.
Vous l’avez faite pour vous, cette âme, ô mon Dieu, pour vous seul; vous avez mis en elle un vide que rien ne peut combler, des aspirations que je puis appeler infinies puisqu’elles s’élèvent sans cesse vers vous comme vers le seul objet capable de la satisfaire et d’étancher la soif qui la dévore.
Hélas! vous le savez, Seigneur, que de fois séduite par de trompeuses apparences, entraînée par de vaines illusions, n’a-t-elle pas demandé aux créatures ce bonheur qu’elle ne peut trouver qu’en vous? Combien de fois ne leur a-t-elle pas donné une trop large place dans son cœur, et prodigué un amour dont vous étiez jaloux et qu’elle devait réserver pour vous seul?
Mais soyez-en à jamais béni; toujours votre divine jalousie est venue se placer entre mon cœur et les objets qui vous le disputaient, et toujours votre miséricordieux amour a permis que je ne rencontre qu’amertume, déceptions, oubli, indifférence, ingratitude, là où j’avais cru ou espéré trouver le bonheur.
Et maintenant, ô mon Dieu, j’ai vécu. Les rêves, les illusions de la jeunesse se sont évanouis comme un songe fugitif qui laisse à peine un faible souvenir. La vie a passé sur mon âme avec toutes ses tristesses et ses douleurs ; chaque année a marqué son passage par quelque nouvelle douleur, quelque nouvelle séparation.
En jetant mon regard en arrière, je ne vois plus que des ruines, que des tombes refermées sur les êtres que j’ai le plus aimés. Le vide, l’isolement s’est fait autour de moi et se fait chaque jour de plus en plus en moi.
Désabusée de tout, mon âme ne demande plus rien aux créatures, elle ne cherche plus ni le repos, ni le bonheur ici-bas, ses espérances s’élèvent plus haut que la terre, et plus encore mon âme se détache de ce monde où tout passe, où tout finit, où bientôt j’aurai passé moi-même sans y laisser autre chose qu’un léger souvenir dans le cœur de quelques amis, souvenir qui s’effacera bientôt, qui passera avec ceux qui me le garderont pour laisser poser sur ma tombe ce voile de l’oubli qui s’étend sur celles de tous ceux qui nous ont précédés dans la vie.
Plus, dis-je, je me détache de ce monde périssable, plus je sens mes espérances grandir et se fortifier, plus je me sens fait pour cette autre vie dont j’entrevois l’aurore dans un prochain avenir. Déjà j’entrevois les radieuses splendeurs du beau jour de l’éternité, et je salue d’avance cette terre de la vraie patrie où rien ne change, où tout est stable, permanent, éternel.
Mais c’est surtout près de votre cœur, ô Jésus, et dans une union intime avec vous, que mon espérance se fortifie, car vous n’êtes pas seulement, Seigneur, l’appui de mon espérance, vous êtes vous-même le bien que j’espère. N’êtes-vous pas le Ciel auquel j’aspire, la vie dont je veux vivre, le bonheur dont je suis affamé, l’amour que je veux éternellement aimer?
Et quand dans votre Eucharistie vous vous donnez à moi, quand vous venez par votre adorable présence adoucir les tristesses de mon long exil, consoler ses douleurs, comment n’espérerais-je pas de votre amour et de votre miséricorde que vous ne me refuserez pas dans l’éternité ce que déjà vous m’aviez si souvent donné sur la terre?
Oui, oui, ô Jésus, je l’espère de votre infinie bonté, vous êtes à moi dans le temps, vous serez encore à moi dans l’éternité. Ici vous vous donnez à moi sous les voiles de cet adorable mystère, je ne vous entrevois qu’à travers les ombres de la foi, mon âme appesantie par les liens qui l’unissent à mon corps ne vous connaît qu’imparfaitement, ne vous aime que faiblement.
Mais le moment approche, et je soupire après lui, comme le prisonnier soupire après l’heure de sa délivrance, où votre main brisera les liens qui retiennent mon âme loin de vous, où vous lèverez tous les voiles, où vous permettrez enfin à la pauvre exilée de la terre de s’abreuver à longs traits aux sources de l’éternel amour, de s’y perdre, de s’y abîmer et de jouir sans crainte de les perdre jamais des inénarrables délices de l’éternelle communion du ciel.
Soyez béni, Seigneur, de m’accorder avant ce suprême bonheur, celui de m’approcher de vous dans votre Eucharistie, de pouvoir m’y unir à vous par la plus intime, la plus sainte de toutes les unions. Là je jouis de vous, ô bien-aimé Sauveur, là je vous trouve seul à seul, je puis épancher mon âme à vos pieds, reposer mon cœur si souvent fatigué des luttes, des orages, des douleurs de la vie sur votre cœur adorable.
Je puis m’entretenir cœur à cœur avec vous dans le silence et le recueillement de cette divine solitude, préférable mille fois à ces fêtes, à ces réunions brillantes dont le monde est avide, qui étourdissent et laissent le cœur vide et sans consolation.
Auprès de vous, ô Jésus, mon âme reprend des forces, elle y puise un nouveau courage pour supporter les épreuves et le poids de la vie; vous lui communiquez une vigueur toute divine qui lui rend plus facile la pratique de la vertu et l’accomplissement du devoir, car vous devenez vous-même ma force, ma lumière et ma vie.
Et puis, ô mon Sauveur, je puis encore à chaque instant du jour vous retrouver dans la solitude de votre tabernacle; rien ne m’interdit l’entrée de votre temple, il est pour moi l’oasis au milieu du désert.
Quand la lassitude s’empare de mon âme, elle peut toujours venir se reposer à vos pieds; quand elle se sent comme desséchée par cette poussière du monde qui s’attache à elle, parce que l’air que nous respirons en est imprégné, elle peut venir à vous qui la faites tomber et qui la lavez et la rafraîchissez avec l’eau de votre divine grâce.
Enfin quand elle est troublée, découragée, quand la douleur la presse, c’est encore auprès de vous qu’elle retrouve la paix, le courage, que ses larmes perdent leur amertume et qu’elle comprend cette divine parole: Bienheureux ceux qui pleurent!
O Marie, vierge immaculée, vous dont le chaste sein fut la première et la plus douce solitude de Jésus; vous qui pendant neuf mois avez possédé seule le trésor et la joie du ciel et qui pendant ce long espace de temps avez reçu du divin solitaire tous les trésors de son amour, et qui êtes entrée en participation de sa vie divine en échange de la vie naturelle qu’il recevait de vous, obtenez-moi l’amour de la solitude intérieure, l’esprit de silence et de recueillement.
Apprenez-moi à attirer Jésus en moi, à l’y retenir, à l’y fixer. Ornez-vous même, ô ma tendre Mère, cette solitude de mon âme si aride, si dénuée de tout ce qui peut la lui rendre agréable, faites-y croître les fleurs de ces humbles et petites vertus dont le parfum lui plaît et qui charment son divin cœur.
Vous êtes riche, ô ma Mère, ayez pitié de l’indigence de votre enfant, faites-le participer à l’humilité, à la douceur, à la pureté, à la charité de votre cœur immaculé, afin que Jésus, en reconnaissant dans mon âme l’image bien imparfaite, hélas! des vertus de sa Mère bien-aimée, s’abaisse vers elle, y entre et y fixe à jamais son séjour. Ainsi soit-il.
Léonie Guillebaut
