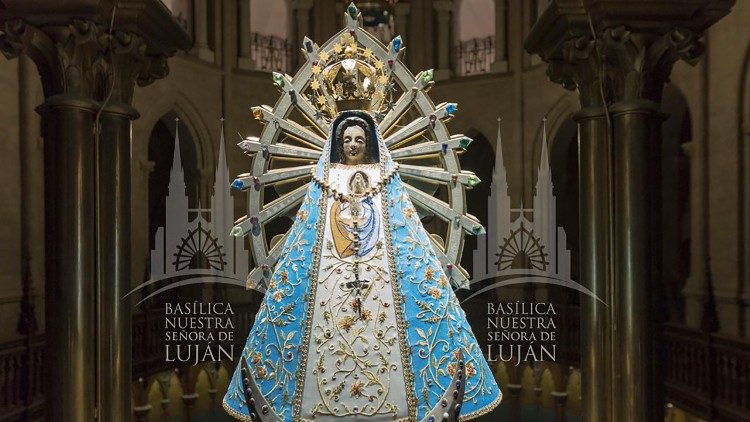CENT QUATRIÈME LECTURE : CINQUIÈME DEMANDE DU NOTRE PÈRE

Et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
J’accepte de grand cœur, ô mon Dieu, la condition à laquelle vous voulez bien m’accorder la rémission de tous mes péchés ; elle m’est trop avantageuse, pour ne pas la remplir avec empressement ; vous avez dit : Pardonnez, et l’on vous pardonnera.
Ah ! Seigneur, si j’ai été offensé en quelque chose, de quelque part que ce soit, je le pardonne, je le pardonne entièrement, je le pardonne non pas de bouche seulement ni en apparence, mais sincèrement, mais du fond de mon cœur ; telle est, à ce qu’il me paraît, ma disposition intérieure.
Loin de moi tout ressentiment, tout désir de vengeance : si, malgré moi, il restait encore dans mon cœur quelque impression capable de l’aigrir, je la désavoue, je veux la combattre, en réprimer tous les sentiments, et en effacer jusques aux moindres vestiges.
Avec cela, mon Dieu ! vous me permettrez de venir à vous et de vous dire : pardonnez-moi, parce que je pardonne ; et, comme je pardonne, vous écouterez votre miséricorde, parce que j’écoute moi-même mon devoir ; je fais ce que vous m’avez ordonné, et j’ose me répondre avec une humble confiance, que vous ferez ce que vous m’avez promis.
Charitable et indulgent envers mes frères, je trouverais en vous un père plein de bonté, de douceur et d’indulgence.
Texte présenté par l’Association de la Médaille Miraculeuse
NB : à ceux qui le demanderont – par contact -, je donnerai gratuitement la version de ces prières, mise en EPUB.
P. J.-Daniel Planchot, cm