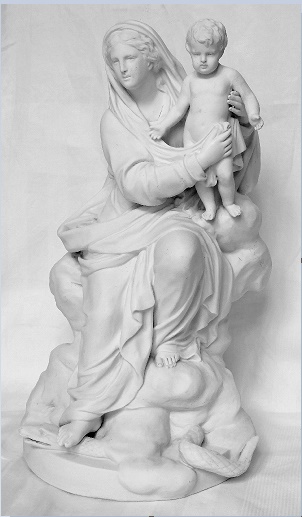Dans un monde d’autosuffisance, nos fragilités sont un pont vers le ciel.
«J’ai soif»: c’est sur ces derniers mots de Jésus sur la croix que Léon XIV s’est attardé dans sa catéchèse lors de l’audience générale place Saint-Pierre ce mercredi 3 septembre. Le Pape a expliqué que l’amour véritable apprend à demander et pas seulement à donner. Demander est ainsi libérateur.
Léon XIV
Place Saint-Pierre
Mercredi 3 septembre 2025
___________________________________
Cycle de catéchèse – Jubilé 2025. Jésus-Christ notre espérance. III. La Pâque de Jésus. 5. La crucifixion. « J’ai soif » (Jn 19,28)
Chers frères et sœurs,
au cœur du récit de la Passion, au moment le plus lumineux et en même temps le plus sombre de la vie de Jésus, l’Évangile de Jean nous livre deux mots qui renferment un immense mystère : « J’ai soif » (19,28), et aussitôt après : « Tout est accompli. » (19,30).
Ultimes paroles, mais chargées d’une vie entière, qui révèlent le sens de toute l’existence du Fils de Dieu. Sur la croix, Jésus n’apparaît pas comme un héros victorieux, mais comme un mendiant d’amour. Il ne proclame pas, ne condamne pas, ne se défend pas. Il demande humblement ce qu’il ne peut en aucun cas se donner à lui-même.
La soif du Crucifié n’est pas seulement le besoin physiologique d’un corps meurtri. Elle est même, et surtout, l’expression d’un désir profond : celui d’amour, de relation, de communion. C’est le cri silencieux d’un Dieu qui, ayant voulu tout partager de notre condition humaine, se laisse aussi traverser par cette soif. Un Dieu qui n’a pas honte de mendier une gorgée, car dans ce geste, il nous dit que l’amour, pour être vrai, doit aussi apprendre à demander et pas seulement à donner.
J’ai soif, dit Jésus, et c’est ainsi qu’il manifeste son humanité et la nôtre. Aucun de nous ne peut se suffire à soi-même. Personne ne peut se sauver seul. La vie “s’accomplit” non pas lorsque nous sommes forts, mais lorsque nous apprenons à recevoir. Et c’est précisément à ce moment-là, après avoir reçu des mains étrangères une éponge imbibée de vinaigre, que Jésus proclame : Tout est accompli. L’amour s’est fait nécessiteux, et c’est précisément pour cela qu’il a accompli son œuvre.
C’est là le paradoxe chrétien : Dieu sauve non pas en agissant, mais en se laissant faire. Non pas en vainquant le mal par la force, mais en acceptant jusqu’au fond la faiblesse de l’amour. Sur la croix, Jésus nous enseigne que l’homme ne se réalise pas dans le pouvoir, mais dans l’ouverture confiante à l’autre, même lorsqu’il nous est hostile et ennemi. Le salut ne réside pas dans l’autonomie, mais de reconnaitre avec humilité son propre besoin et de savoir l’exprimer librement.
L’accomplissement de notre humanité dans le dessein de Dieu n’est pas un acte de puissance, mais un geste de confiance. Jésus ne sauve pas par un coup de théâtre, mais en demandant quelque chose qu’il ne peut se donner à lui-même. Et c’est là que s’ouvre une porte sur la véritable espérance : si même le Fils de Dieu a choisi de ne pas se suffire à lui-même, alors notre soif – d’amour, de sens, de justice – n’est pas un signe d’échec, mais de vérité.
Cette vérité, apparemment si simple, est difficile à accepter. Nous vivons à une époque qui récompense l’autosuffisance, l’efficacité, la performance. Pourtant, l’Évangile nous montre que la mesure de notre humanité n’est pas donnée par ce que nous pouvons conquérir, mais par notre capacité à nous laisser aimer et, quand cela est nécessaire, aussi aider.
Jésus nous sauve en nous montrant que demander n’est pas indigne, mais libérateur. C’est le moyen de sortir de la dissimulation du péché, pour retourner dans l’espace de la communion. Dès le départ, le péché a engendré la honte. Mais le pardon, le vrai, naît lorsque nous pouvons regarder en face notre besoin et ne plus craindre d’être rejetés.
La soif de Jésus sur la croix est donc aussi la nôtre. C’est le cri de l’humanité blessée qui cherche encore l’eau vive. Et cette soif ne nous éloigne pas de Dieu, elle nous unit plutôt à Lui. Si nous avons le courage de la reconnaître, nous pouvons découvrir que notre fragilité est aussi un pont vers le ciel. C’est précisément en demandant – et non en possédant – que s’ouvre une voie de liberté, car nous cessons de prétendre nous suffire à nous-mêmes.
Dans la fraternité, dans la vie simple, dans l’art de demander sans honte et de donner sans calcul, se cache une joie que le monde ne connaît pas. Une joie qui nous ramène à la vérité originelle de notre être : nous sommes des créatures faites pour donner et recevoir de l’amour.
Chers frères et sœurs, dans la soif du Christ, nous pouvons reconnaître toute notre soif. Et apprendre qu’il n’y a rien de plus humain, rien de plus divin, que de savoir dire : j’ai besoin. N’ayons pas peur de demander, surtout quand nous pensons ne pas le mériter. N’ayons pas honte de tendre la main. C’est précisément là, dans ce geste humble, que se cache le salut.
* * *
Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Luxembourg et de France. Frères et sœurs, apprenons l’art de demander sans honte et d’offrir sans calcul, nous construirons ainsi des relations fraternelles, vraies et authentiques porteuses d’une joie que le monde ne connaît pas.
Que Dieu vous bénisse et vos familles.
APPEL
Des nouvelles dramatiques nous parviennent du Soudan, en particulier du Darfour. À El Fasher, de nombreux civils sont pris au piège dans la ville, victimes de la famine et des violences. À Tarasin, un glissement de terrain dévastateur a fait de très nombreux morts, laissant derrière lui douleur et désespoir.
Et comme si cela ne suffisait pas, la propagation du choléra menace des centaines de milliers de personnes déjà épuisées. Je suis plus que jamais proche de la population soudanaise, en particulier des familles, des enfants et des personnes déplacées. Je prie pour toutes les victimes.
Je lance un appel pressant aux responsables et à la communauté internationale afin que des couloirs humanitaires soient garantis et qu’une réponse coordonnée soit mise en œuvre pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire. Il est temps d’entamer un dialogue sérieux, sincère et inclusif entre les parties afin de mettre fin au conflit et de redonner espérance, dignité et paix au peuple du Soudan.
Résumé de la catéchèse du Saint-Père :
Parmi ses dernières paroles sur la croix, Jésus a dit “j’ai soif ”. Il ne se présente pas comme un héros victorieux, mais comme un mendiant d’amour. La soif du Crucifié est avant tout l’expression d’un désir profond : celui d’amour, de relation, de communion.
Par ce geste, Dieu nous dit que, pour être véritable, l’amour doit aussi apprendre à demander et pas seulement à donner. Sur la croix, Jésus nous enseigne que l’homme ne se réalise pas dans le pouvoir, mais dans l’ouverture confiante à l’autre, même lorsqu’il est hostile.
Le salut ne réside pas dans l’autonomie, mais dans la reconnaissance humble de son propre besoin et dans la capacité à l’exprimer librement. L’accomplissement de notre humanité dans le dessein de Dieu n’est pas un acte de force, mais un geste de confiance. Et c’est là qu’une porte s’ouvre sur la véritable espérance : notre soif – d’amour, de sens, de justice – n’est pas un signe d’échec, mais de vérité.
À une époque qui récompense l’autosuffisance, l’efficacité, la performance, l’Évangile nous montre que la mesure de notre humanité n’est pas donnée par ce que nous pouvons conquérir, mais par notre capacité à nous laisser aimer. La soif de Jésus sur la croix est le cri de l’humanité blessée qui cherche encore l’eau vive. C’est précisément en demandant – et non en possédant – qu’une voie de liberté s’ouvre, car nous cessons de prétendre nous suffire à nous-mêmes.
Copyright © Dicastère pour la Communication – Libreria Editrice Vaticana